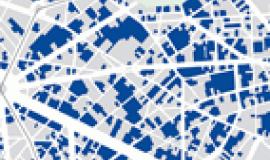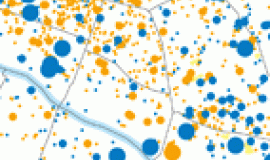Les quartiers d’affaires de la Métropole du Grand Paris – Enjeux et perspectives
L’avenir du travail est parfois regardé comme beaucoup plus éclaté qu’aujourd’hui. Le temps des horaires fixes, du salariat et de la hiérarchie pyramidale serait en passe d’être révolu. Le travail tendrait à devenir diffus dans sa géographie, flottant dans le temps, dispersé dans ses modalités. Le développement des modes de travail nomades – co-working, télétravail, postes mobiles – conduiraient à l’obsolescence d’une partie du parc tertiaire. Plutôt que des grands pôles qui génèrent de grands mouvements pendulaires, se développerait une multitude de micro polarités, réduisant les distances entre domicile et lieux de travail.
En opposition à cette théorie, de nombreuses études font valoir les bénéfices de la concentration spatiale des entreprises : partage des risques, spécialisation, partage des aménités productives, effets d’appariement, interactions sociales, création, diffusion et accumulation de savoir. Tous ces effets permettent de comprendre pourquoi la concentration spatiale des activités tertiaires ne va pas disparaître. Les effets d’agglomération prédominent encore largement sur les forces centrifuges.
A l’initiative de Jean-Louis Missika, adjoint au maire de Paris chargé de l'urbanisme, de l'architecture, des projets du Grand Paris, du développement économique et de l'attractivité, un groupe de travail d’élus confrontés au premier chef à ces questions s’est constitué en 2015 pour envisager l’avenir des grands quartiers d’affaires de la métropole. Une mission d’étude a été confiée aux équipes de l’AIGP (Atelier International du Grand Paris).
Parallèlement l’Apur a missionné une équipe du Master de Sciences-Po « Governing large metropolis » pour réaliser un benchmark international des quartiers d’affaires.
Cette note cherche à rendre compte de l’ensemble de ces réflexions qui souvent convergent ou se complètent.